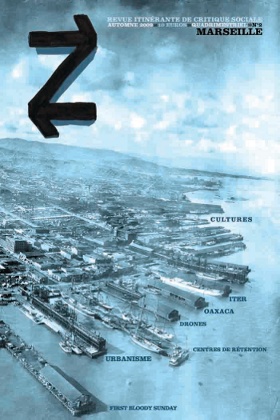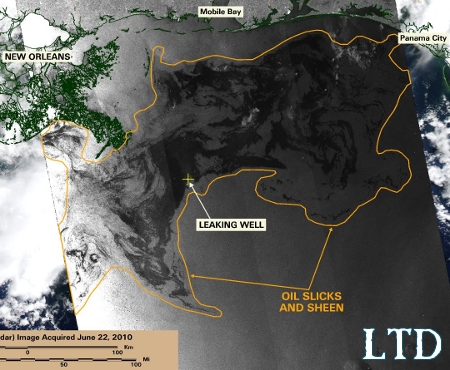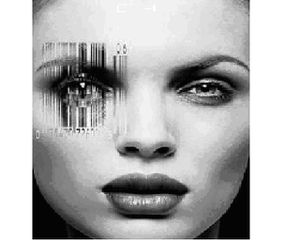Ayant publié le court texte citant
Angela Davis, aujourd'hui on publie une remise en question de la sororité, a partir d'une analyse d', Andrea Martinez est professeure titulaire et directrice de l’École de
développement international et mondialisation à l’Université d’Ottawa. Elle a publié de nombreux articles et chapitres de livres sur la violence, le trafic international des femmes et l’éducation
en santé sexuelle. Première coordinatrice (2001-2004) du Réseau interaméricain de formation en femmes et développement du COLAM, elle possède également une expérience de six ans comme directrice
(2000-2006) de l’Institut d’études des femmes de l’Université d’Ottawa. Au cours de sa carrière, elle a bénéficié de subventions du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, des
Instituts canadiens de recherche en santé, de l’Agence canadienne de développement international, du Centre de recherche en développement international et de l’UNESCO, entre autres.. À ce titre,
elle a d’ailleurs contribué à la création du premier programme interdisciplinaire et interuniversitaire en « Genre et développement » du Cameroun.
Depuis l’avènement des thèses postmodernes et postcoloniales, et son corollaire, l’effondrement de l’idéal féministe occidental d’une
sororité prétendument lisse et universelle, la quête d’une authenticité fondée sur les différences entre les femmes nous aveugle au point de gommer nos appartenances multiples et sérielles. Aussi
je me propose de décentrer ce « nous » piégé par des représentations binaires et statiques, à la lumière des contributions des féministes d’Amérique latine et des Caraïbes à l’approche
intersectionnelle des discours et des systèmes d’oppression. L’analyse de la complexité des mouvements féministes du sous-continent révèle les ressorts des alliances, mais aussi des déchirements
qui les traversent depuis le premier congrès féministe international (Buenos Aires, 1910), en passant par l’émergence du féminisme noir caribéen des années 1930, jusqu’à la scission contemporaine
des courants féministes « institutionnalismes » et « autonomistes ».
« Faut-il réfuter le Nous-femmes pour être féministe au XXIe siècle? ». Et si cette question résultait d’un sophisme
par la conséquence? Suivant ce procédé, on postule que le féminin pluriel a perdu de son pouvoir de ralliement. Si cette prémisse est vraie, alors l’effritement du projet féministe est vrai
aussi. Mais une telle conséquence est irrecevable dans le milieu féministe. On en déduit alors l’incohérence d’un « nous » qui n’en serait pas un : exit « l’imposteur »,
place à la re-théorisation du pluriel. Comme s’il suffisait de rejeter le concept en cause pour effacer les bavures d’un projet de transformation sociale centré sur le sexisme, mais déconnecté
des autres formes et dynamiques croisées d’exclusion (sociale, « raciale », ethnique, sexuelle, nationale, religieuse, générationnelle ou autre). Entre temps, culpabilité et malaise
identitaire crispent les mouvements féministes à l’échelle locale autant que globale. Car, pour complexifier davantage la donne, il faut se méfier de sa position par rapport au sujet suspect.
Ainsi, qu’est-ce qui me rapproche, ou au contraire, m’éloigne de ce dernier? Suis-je au centre ou à la périphérie?
Féministe universitaire, blanche, de classe moyenne et hétérosexuelle, j’incarne autant de marqueurs d’une position de pouvoir qui
d’office m’interdisent de parler au nom de toutes les femmes. Dois-je alors me replier sur certains particularismes ethnoculturels puisant à même ma condition de femme du Sud et d’immigrante
d’origine chilienne plus précisément? Au nom du droit à la différence, me voilà dotée d’un statut minoritaire en pièces détachées : exilée politique, allophone, néo-canadienne, mon
engagement féministe devra se contenter d’une identité fragmentée. Du coup, je me trouve confrontée au choix des « identités meurtrières » dénoncé par Maalouf (1998 : 9)
en ces termes : « Serais-je plus authentique si je m’amputais d’une partie de moi-même? ».
Depuis l’avènement des thèses postmodernes et postcoloniales, et son corollaire, l’effondrement de l’idéal féministe occidental d’une
sororité prétendument lisse et universelle, le débat ne cesse en effet de s’articuler en termes dichotomiques : comment départager les « vraies » des « fausses »
féministes? La quête d’une authenticité fondée sur les différences et les clivages entre les femmes nous aveugle au point de gommer nos appartenances multiples et sérielles, pourtant essentielles
à la « diversité constitutive des femmes » (Fougeyrollas-Schewbel et coll., 2005 : 5). Aussi je me propose de décentrer ce « nous » piégé par des représentations binaires
et statiques, à la lumière des contributions des féministes d’Amérique latine et des Caraïbes à l’approche intersectionnelle des discours et des systèmes d’oppression. Généralement absentes des
échanges féministes francophones, en raison notamment des barrières linguistiques, leurs réflexions vont pourtant bien au-delà du rôle de « dissidentes » périphériques auquel les
réduisait récemment le numéro spécial de Nouvelles Questions Féministes (NQF, 2005).
Faute de pouvoir restituer toute la complexité des mouvements féministes du sous-continent, j’exposerai d’abord les ressorts des
alliances qui ont façonné leur histoire, depuis leur émergence à la fin du XIXe siècle jusqu’à nos jours. M’appuyant sur un corpus de la littérature endogène aussi vaste que dispersé (cours,
présentations orales disponibles sur le web, articles et monographies), je préciserai notamment le rôle desdites alliances dans les questionnements relatifs au croisement des rapports de
pouvoir par lesquels se construisent les inégalités; processus que la juriste américaine Kimberlé W. Crenshaw (1991) a désigné a posteriori sous le nom
d’« intersectionnalité ». Ensuite, je montrerai que les traits d’union tracés au fil des combats s’articulent à des lignes de fracture (dont l’affrontement monté en épingle par NFQ
entre féministes autonomistes et institutionnelles) qui suscitent à leur tour une critique de l’essentialisme des différences et un appel à l’intégration solidaire de la diversité. En conclusion,
je dégagerai quelques leçons sur le potentiel tout à la fois inclusif et transformateur de l’analyse intersectionnelle pour parer aux risques d’atomisation sinon de désintégration de l’action
féministe.
De la charité à la solidarité
Malgré que les travaux des historiennes situent les premières luttes féministes d’Amérique latine et des Caraïbes vers la fin du
XIXe et le début du XXe siècle (Navarro et Sánchez Korrol, 1999), leurs revendications reflètent les préoccupations en matière de droits sociaux et politiques d’une élite
instruite, urbaine et de classe moyenne. Mis à part quelques tentatives de la part de certaines factions plus radicales qui réclament l’amélioration des conditions de travail des femmes des
classes pauvres, leur approche de l’émancipation emprunte, pour l’essentiel, un maternalisme moralisateur (Sanchez Korrol, 1999). D’ailleurs l’identité discursive de ces premières féministes est
dominée par l’équivalence « femme égale mère ». Partant de l’expérience argentine, Fernanda Gil Lozano et coll. (2000 : 13) notent à ce propos que, dans les années 1900,
« Toutes les femmes ont naturalisé la maternité puis amorcé leurs luttes à partir de cette conception »1. Or cette conception universaliste s’accommode mal des réalités
quotidiennes des femmes pauvres qui doivent lutter pour leur survie. À la même époque, dans les Caraïbes anglophones, ce sont les clubs de femmes « de couleur » (noires et métisses) de
classe moyenne également qui font campagne pour les droits politiques des femmes, l’éducation des filles et les premières réformes légales. Mais là encore, c’est la charité davantage que la
sororité qui décrit le mieux la relation des femmes de l’élite noire à l’endroit de leurs homologues de classes différentes (Reddock, 1994, 1995).
Plus surprenante au regard de la question des intersections des systèmes d’oppression est, en revanche, la recherche stratégique
d’alliances à l’échelle intra régionale. Amorcées dans le cadre du premier congrès féministe international de Buenos Aires (Argentine), célébré en 1910 avec la participation d’associations de
femmes de diverses couleurs et nationalités (Brésil, Paraguay, Uruguay et Chili), ces alliances acquièrent une signification nouvelle avec l’inauguration dans les années 1930, en Jamaïque, du Pan
African Association et du United Negro Improvement Association (dont les ramifications s’étendent jusqu’à Cuba). Pour la première fois, les féministes « de couleur » et les femmes des
classes laborieuses disposent d’une plate-forme pour faire valoir leurs droits, malgré que leurs discours ne parviennent pas encore à rompre avec l’image homogène et colonialiste des femmes
(French et Ford-Smith, 1985). Il semble toutefois que ce soit la prise de conscience de la valeur de leur travail — essentiel au fonctionnement desdites associations et paradoxalement dépendant
de la masculinité noire — qui ait contribué à l’émergence du féminisme noir caribéen des années 1930 (Ford-Smith, 2004 : 30). Henrice Altink (2006 : 7-9) souligne en outre que la
discrimination sur la base de la couleur de peau est au cœur des questions qui préoccupent les féministes noires jamaïcaines — telles Una Marson et Amy Bailey — dans la période
d’entre-deux-guerres. Elle ajoute que les débats de l’époque sur le racisme ne concernent pas seulement les rapports entre femmes blanches et noires, mais aussi ceux entre femmes aux divers
« tons » plus ou moins foncés. Un constat qui, selon Rhoda Reddock (2007 : 8), témoigne déjà d’une solidarité féministe antiraciste :
Colour and shade distinctions may have had a similar impact on feminist solidarity then as ‘race’ and ethnic differences may be having
today. At the same time therefore as these feminists sought the valorisation of their colour and ‘race’ they collaborated with “White’ feminists such as May Farquharson in Jamaica and Beatrice
Greig and Gema Ramkeesoon in Trinidad and Tobago, and worked to combat shadism and colour prejudice among African-descended women within their societies.
De tels rapprochements antiracistes demeurent cependant ponctuels et somme toute marginaux à l’échelle régionale où prédomine un
féminisme ancré dans des systèmes hiérarchisés contribuant au maintien des privilèges des femmes blanches. Et ce, en dépit des variations historiques des procédés de « racialisation »
qui règlent la stratification sociale et économique des Caraïbes et de l’Amérique latine en fonction de l’héritage colonial, des modèles de production ou encore de l’origine et de l’apport
des flux migratoires (Reddock, 2007).
Si, par ailleurs, la conquête du droit de vote s’effectue de manière très inégale selon les pays (période de 1929 à 1964), elle
s’accompagne systématiquement d’un reflux des luttes féministes reconnaissable au repli vers le domestique (Kirkwood, 1987). Ce n’est qu’à partir des années 1970, période marquée par le
militantisme de rue et la résistance aux dictatures, que leurs combats rebondissent au fur et à mesure que se construisent de nouvelles formes de socialisation et de nouveaux pactes entre les
femmes. Bien que ces coalitions restent traversées par les influences nord-américaines et européennes, elles s’en démarquent néanmoins par l’historicité des réalités matérielles propres à
la région. Comme l’explique la bolivienne Raquel Gutiérrez Aguilar (1999 : 27-28) :
Les critiques aux concepts et catégories européens et états-uniens ont accompagné toute l’histoire de la pensée en Amérique latine,
parce qu’il est impossible de récupérer des universaux (qu’ils soient idées ou signes) pour interpréter des sociétés où il n’y a pas d’unité politique de base (…). Le féminisme latino-américain
(et j’ajouterai, caribéen) a dû chercher en son sein les différences vitales qui le composent, sans qu’aucun de ses courants ne se soit jamais perçu comme « quelque chose" de distinct du
féminisme.
Une vision que partage la philosophe mexicaine Francesca Gargallo (2004), pour qui l’originalité de leur action réside dans leur
capacité à véhiculer en permanence la contingence politique et économique du sous-continent. En témoignent les luttes livrées par les féministes chiliennes contre le régime de Pinochet sous
le slogan « Démocratie au pays et à la maison ». Ce slogan est d’ailleurs repris par les féministes de la région qui y ajoutent la dimension intime « et au lit » pour marquer
« non seulement le caractère politique du privé, mais aussi une forme différente et radicale de comprendre la démocratie » (Vargas, 2003).
« Démocratie au pays, à la maison..... et au lit »
Dans les pays du cône Sud, la décennie 1970 cristallise une période sombre de coups militaires à la chaîne, dont la violence et la
terreur se mesurent aux souffrances de milliers de femmes et d’hommes condamnés à la torture, à l’emprisonnement et à l’exil. Remplissant le vide laissé par la dissolution des partis politiques,
l’action des militantes féministes dites de la « deuxième vague » s’organise en faveur de la démocratie et des droits humains : libération des prisonnières/prisonniers politiques,
dénonciation des exactions des forces armées, accès au logement, à l’éducation et à la santé. Le rejet marqué de toute forme de pouvoir, désormais identifié à la domination et à la
violence masculines (Maffía et Kurschnir, 1994), s’articule aux revendications des droits civils et politiques qui questionnent les expériences de la vie quotidienne, à commencer par la maternité
et la sexualité. Comme le précise Cecilia Lipszyc (1997, citée dans Guzzetti et Fraschini, sans date : 2), ce néo-féminisme participe d’un « double processus : d’un côté, la
déconstruction des rôles assignés aux femmes depuis les Lumières, de l’autre, leur transformation en sujets politiques ». Toutefois, nous sommes encore loin d’un mouvement organisé et
structuré autour d’objectifs concrets.
Toujours dans les années 1970, les guerres de libération nationale d’Amérique centrale mobilisent des femmes combattantes, tandis
qu’au Mexique et dans les Caraïbes la spontanéité bruyante des manifestations féministes émane de petits groupes de militantes où se précise un travail d’analyse de la dénommée « condition
de la femme ». La réflexion, pour l’instant extérieure aux sphères universitaires, demeure cependant guidée par la lutte « des pays dépendants contre l’impérialisme » (Di Tella et
coll., 2001 :179). De fait, certaines féministes continuent de pratiquer la double militance, autrement dit l’appartenance simultanée au mouvement féministe ainsi qu’à un parti politique, alors
que d’autres, appelées les « cooptées », s’infiltrent dans le parti officiel ou le gouvernement pour mieux propulser les idées féministes depuis l’intérieur. Le lancement, à Mexico, de
la Décennie de la femme en 1975 favorise le développement d’études statistiques et descriptives sur la situation des femmes; un phénomène qui à son tour contribue à la création de programmes en
études des femmes et de genre au cours de la décennie suivante (Garrido, 2004).
D’ailleurs, dès 1979, les mexicaines Eli Bartra et Adriana Valadés (1985 : 129) sont parmi les premières à secouer les milieux
universitaires en affirmant que le féminisme est la « lutte consciente et organisée des femmes contre (un) système (…) classiste, mais aussi sexiste et raciste qui exploite et opprime de
multiples façons tous les groupes en marge des sphères du pouvoir ». Entre temps, la bataille dans les rues s’alimente à même quatre grands thèmes : avortement, pauvreté, viol et
violence contre les femmes. Dans un livre plus récent, Eli Bartra (2000 : 43-44) ajoute que le fait d’être un mouvement de classe moyenne, mais fortement influencé par l’anarchisme, le
marxisme ou le socialisme suscite chez de nombreuses militantes un « sentiment de culpabilité » issu de la prise de conscience de leurs privilèges de classe. D’où la tendance à un
rapprochement accru avec les femmes des secteurs plus pauvres favorisant l’émergence d’un féminisme populaire. Ainsi, écrit-elle,
Lorsque au Mexique les femmes urbaines, de classe moyenne et majoritairement métisses luttent pour la décriminalisation de
l’avortement, ce ne sont pas seulement leurs intérêts qu’elles défendent : celles qui sont les plus touchées par l’avortement clandestin sont les femmes pauvres, notamment les autochtones.
En ce sens, la lutte pour décriminaliser l’avortement bénéficie à toutes les femmes, et tout particulièrement à celles des milieux marginalisés (Bartra, 2000 : 52).
Dans cette optique, les revendications sur le terrain des droits reproductifs posent un nouveau jalon dans la construction d’un
féminisme plus ouvert aux expériences multiples des femmes. Aussi la politisation de la vie privée trouve un terreau fertile dans les Encuentros (rencontres) féministes d’Amérique
latine et des Caraïbes, menés à intervalle régulier depuis 1981. En marge de leurs actions auprès des gouvernements locaux et des agences supranationales, ces rencontres offrent l’occasion de
mettre à l’épreuve les grilles d’analyse ainsi que les acquis du féminisme latino-américain et caribéen. La marche vers Beijing éveille l’optimisme des féministes qui misent sur la
transnationalisation d’un processus de réseautage entre mouvements régionaux et mondiaux pour rendre visibles des femmes (notamment les afros-descendantes, les autochtones, les lesbiennes et les
femmes handicapées) restées jusque-là généralement à l’écart du mouvement féministe (Vargas, 1998, 2003; Alvarez, 1998, 2000).
Or, en 1988, la IVe Rencontre Féministe d’Amérique latine et des Caraïbes qui se tient au Mexique marque l’affrontement entre le
mouvement des femmes et quelques féministes autonomes qui ne travaillent pas avec les secteurs populaires. La composante radicale du mouvement commence à s’essouffler au profit d’un féminisme
d’assistance sociale centré sur l’offre d’informations et de services-conseils juridiques, médicaux et psychologiques pour femmes battues et violées. Tandis que des avancées importantes
s’observent sur le plan de la législation contre la violence, les questions plus polémiques tels l’avortement, le divorce et la sexualité, sont mises de côté. Démarre ainsi le processus
d’« ongéisation » du féminisme qui va s’amplifier au cours de la décennie 1990. Ce processus est habituellement défini comme la transformation du mouvement féministe en une multitude
d’organisations non gouvernementales (ONG) et d’organismes gouvernementaux créés à l’intention des femmes, et au sein desquelles celui-ci s’institutionnalise. Il importe ici de signaler que, au
moment de leur création, les ONG de femmes répondent à un besoin réel : elles remplissent la fonction de canaliser la militance sociale comme un succédané au retrait de l’État
providence. Eu égard aux maigres ressources existantes, elles doivent donc se tourner vers le financement externe pour pouvoir exister. Progressivement, cependant, elles sont
« aspirées » par l’ordre du jour des bailleurs de fonds qui les installent dans une logique à la fois bureaucratique (un travail salarié en qualité « d’expertes ») et
compétitive (lutte pour l’obtention des fonds).
Aux espoirs des années 1980, fondés sur le retour ou l’approfondissement de la démocratie dans toutes les sphères de la vie des
femmes, succèdent bientôt la désillusion et la frustration des promesses déçues. Le bilan de Cristina Camuso (1997 : 7) est révélateur des tensions qui annoncent les premières lignes de
fracture au sein du mouvement : « Beijing exprime l’initiative bourgeoise pour que la lutte des femmes soit cooptée par le financement externe et le pragmatisme de l’ici et du
maintenant ».
Les lignes de fracture
Avec la défaite des idéologies marxistes et l’affaiblissement des syndicats, la transition vers des espaces démocratiques s’effectue
sur fond de crise de la dette, crainte du conflit et politiques d’ajustement structurel. L’étude de Raquel Olea (1999 : 56) sur le Chili postdictature illustre le contexte de la réflexion
féministe des années 1990 : au nom de la concertation, « la transition a eu besoin d’un corps social et consensuel pour imposer, à l’abri de la loi, les modèles de conscience et les
valeurs nécessaires à l’ordre néolibéral ». Après une période de relative homogénéité identitaire (anti-impérialiste et anti-dictature), les féministes doivent composer avec des voix
soucieuses d’afficher leurs différences d’une part, et le repositionnement des partis politiques comme principaux interlocuteurs de l’État, d’autre part. Entre 1994 et 1996, le mouvement
est scindé en deux courants, dont l’un (« institutionnaliste ») gravite autour d’une logique de lobbying auprès de l’État et des organismes internationaux, et l’autre (autonomiste),
autour d’une logique militante isolée et fortement critique à l’endroit des membres du premier et du système politico-économique dominant (Ríos et coll., 2005 : 90).
Le malaise atteint son paroxysme à l’occasion de la VIIe Rencontre féministe d’Amérique latine et des Caraïbes qui se tient au Chili
en 1996. Les accusations les plus dures proviennent des autonomistes chiliennes et boliviennes – telles Margarita Pisano et María Galindo - qui déclarent : « Nous nous voulons plus être
tolérantes avec celles qui nous négocient et nous nient » (Camuso, 1997 : 3). Loin de créer des passerelles, l’hostilité des discussions contraint les féministes qui ne se sentent pas
représentées par les courants antagonistes à se regrouper sous la bannière « Ni les unes, ni les autres ». Prenant acte de cette fracture, Cristina Camuso (1997 : 9)
conclut : « il a fallu admettre qu’il n’existe pas un féminisme sinon diverses postures et perspectives philosophiques qui participent de différentes traditions et mémoires des actions
menées par les femmes en vue de diverses projections du futur ».
Parmi ces projections, la perspective du système de genre, relayée par des féministes comme Teresita de Barbieri (2002; 2004), Marta
Lamas (1996, 2002), Sara Poggio, Montserrat Sagot et Beatriz Schmukler (2001), parmi les plus connues, récolte des critiques virulentes. Accusées tantôt de
révisionnistes tantôt de vendues à l’ennemi, on reproche aux partisanes du genre de confondre militance avec neutralité technique, deux concepts qui, en fait,
reproduisent une vision binaire du féminisme (Barriga, 2003). Un autre aspect litigieux tient aux origines du concept même. Certaines l’attribuent à tort à des féministes universitaires,
négligeant la contribution des groupes de femmes de la base telle DAWN (Antrobus, 2007). En revanche, la critique est fondée lorsqu’elle dénonce l’instrumentalisation occidentale du genre, depuis
que les agences internationales (Banque mondiale et Fonds monétaire international en-tête) se sont réapproprié le terme pour s’attaquer à la pauvreté des femmes. À ce propos, la critique d’Esther
Vincente (2005) sur la féminisation de la pauvreté (terme utilisé pour désigner la pauvreté spécifique aux femmes) coupe court à l’approche essentialiste. Dès lors que la pauvreté est une réalité
multidimensionnelle, façonnée par l’intersection des identités et des sources d’oppression diverses (racisme, classisme, xénophobie, lesbophobie), elle se manifeste de façon différenciée.
Autrement dit, toutes les femmes ne vivent pas la pauvreté de la même façon. À l’heure de la « MacDonaldisation », des maquilas et de la dollarisation (Cardoza, 2005), la
détérioration des conditions de vie, incluant la pauvreté, la violence et autres formes de privation des femmes laissées-pour-compte (afros-descendantes, autochtones, lesbiennes, déplacées et
réfugiées, mères adolescentes, victimes du VIH ou trafiquées sexuellement), requiert d’une réflexion féministe appelant de nouvelles formes de solidarité.
À la recherche de nouvelles solidarités
Faisant écho aux propos d’Eudine Barriteau (2003), Adriana Gómez (2003) rappelle que le féminisme latino-américain et caribéen a
souvent occulté les expériences de discrimination croisée des femmes « de couleur » et autochtones, malgré la présence d’environ 150 millions de personnes afros-descendantes, soit près
de trois fois la population autochtone, dont plus de la moitié sont des femmes. Concentrées principalement au Brésil, en Colombie, au Pérou, dans les Caraïbes insulaires et continentales
d’Amérique centrale, ces populations représentent près d’un tiers de la population latino-américaine, ce qui, en chiffres absolus, n’en fait pas une minorité à proprement parler (Campbell Barr,
2003, 2006). Une distorsion semblable s’applique aux populations autochtones (vivant également dans des conditions de grande précarité) qui, totalisant huit à 15 pour cent de la population
latino-américaine, constituent plus de la moitié de la population dans des pays comme la Bolivie, le Guatemala et le Pérou (Valenzuela et Rangel, 2004).
En plus de créer une fausse perception de la réalité, le construit de « minorités » renforce les positions dominantes et
hégémoniques des groupes qui se sont historiquement imposés comme des majorités. Sur ce point, Rawwida Baksh Soodeen (1998) établit une distinction entre la théorisation féministe fortement
polarisée des rapports majoritaires/minoritaires à partir d’une analyse « amère » des différences ethniques et raciales élaborée aux États-Unis et en Europe, et celle, inspirée d’une
tradition anticoloniale fondée sur les « similitudes dans les différences » de la région des Caraïbes. Aussi, plutôt que de simplement célébrer la diversité, elle nous invite à faire
des différences un mécanisme pour montrer l’interconnexion. Dans la même veine, Ochy Curriel (2003 :15) suggère de reconnaître les diversités à l’intérieur de la catégorie femme au
moyen de coalitions coordonnées qui « évitent l’essentialisme situant les femmes noires ou lesbiennes dans une niche, autant que l’universalisme faisant des expériences de toutes les femmes
une unité d’analyse indifférenciée ». Au même titre qu’il faut cesser de « naturaliser les inégalités construites socialement » (Careaga Perez, 2001: 4), il importe donc de rompre
avec les lectures culpabilisantes et démobilisatrices des différences, héritées des courants féministes postcoloniaux et postmodernes de l’Occident. Des courants qui, selon Bartra (2000 :
51), conduisent en outre à ostraciser celles qui ne répondent pas aux marqueurs raciaux ou ethniques de l’oppression, au risque de certains paradoxes. Ainsi, « si une femme blanche est
violée par un homme de couleur, qui est le maître? Et qui l’esclave? » D’où le dilemme souligné par Vargas (2003) : « ignorer la différence nous conduit vers un manque de
neutralité, mais la placer au centre peut l’accentuer et la recréer. Et la différence finit par valoir pour elle-même, et non dans son interrelation transformatrice ».
Quelques notes d’espoir en guise de conclusion
Sur la base de cette trajectoire en condensé, j’estime qu’il est difficile de réfuter le « nous femmes », car cela nous
mènerait, selon les mots de Maruja Barriga (2003), droit vers un cul-de-sac, soit celui de « nier l’histoire, de spéculer sur un passé idéalisé (libre d’ONG de féministes “vendues”) et un
futur (purifié), pour nous libérer de tout mal ». De façon plus constructive, on peut envisager une proposition politique articulée aux différences, c’est-à-dire prenant en compte les
intersections des divers systèmes d’oppression, de marginalisation et d’exclusion, sans pour autant sombrer dans ce que Alda Facio (2002) appelle les : « cosmovisions
partielles ». Si, par ailleurs, la conquête de la citoyenneté pleine et entière, « au pays, à la maison et au lit », reste en plan, seules des alliances avec les secteurs de
femmes traversées par les divers systèmes de domination et fondées sur la solidarité et la coresponsabilité (Sabanes Plou, 2005) pourront venir à bout des disputes stériles entre identités
essentialisées. Enfin, et c’est malheureusement une composante que je n’ai pas pu couvrir faute de temps, il convient d’assurer un dialogue avec les nouvelles générations, à défaut de quoi
féminisme ne rimera plus qu’avec de « vieux ismes ». À nous maintenant de tisser des liens pour renouer avec l’espoir d’une société plus juste et égalitaire!
Références bibliographiques
Alvarez, Sonia E. (1998). Translating the Global: Effects of Transnational Organizing on Local Feminist Discourses and Practices in
Latin America. http://www.antenna.nl/~waterman/alvarez.html
______ (2000). Translating the global: Effects of the transnational organizing on local feminist discourses and practices in Latin
America, PPGSP/UFSC, Cadernos de Pesquisa, nº 22, Octobre.
Alrink, Henrice (2006). “The Misfortune of being black and female”: Black Feminist Thought in Interwar Jamaica”, Thirdspace,
5, No 2. Disponible sur le site web:
http:www.thirdspace.ca/vol5/5_2_Altink.htm
Antrobus, Peggy (2007). Le mouvement mondial des femmes, Montréal : Les Éditions Écosociété et Enjeux Planète.
Baksh-Soodeen, Rawwida (1998). “Issues of Difference in Contemporary Caribbean Feminism”, Feminist Review 59, No. 1:
74-85.
Barriga, Maruja (2003). Los malestares del feminismo latinoamericano: una nueva lectura, La Iniciativa de Comunicación.
Octobre.
Bartra, Eli et Valadés, Adriana (1985). La naturaleza femenina. Tercer coloquio nacional de filosofía, México:
UNAM.
Barriteau, Eudine (2003). Confronting Power, Theorizing Gender: Interdisciplinary Perspectives in the Caribbean, University
Press of the West Indies, Kingston: Jamaica.
Bartra, Eli., Fernández Poncela, Anna M., Lau, Ana. (2000). Feminismo en México, Ayer y Hoy, Mexico : Universidad
Autónoma Metropolitana, Colection Molinos de Viento.
________ (1998). “Reflexiones metodológicas”, dans Eli Bartra (sous la direction de), Debates en torno a una metodología
feminista, México D.F, UAM-Xochimilco.
Camusso, Cristina, 1997. Controversias y desencuentros en el feminismo latinoamericano. Disponible sur le web : http://www.geocities.com/Athens/Agora/5166/16mujer.html
Campbell Barr, Epsy et Careaga, Gloria (2002) (sous la direction de). Poderes Cuestionados: sexismo y racismo en
América Latina. Red de Mujeres Afrocaribeñas y Afrolatinoamericanas, Programa Universitario de Estudios de Género, UNAM. San José, Costa Rica.
Cambell Barr, Epsy (2003). ‘El impacto económico del racismo y el sexismo sobre las mujeres afrodescendientes de América Latina y el
Caribe’ en Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, Discriminación de Género/Raza/ Etnia: Mujeres negras e indígenas alzan su voz, pp.40-42.
_________ (2006).“Racismo y Sexismo sobre las Mujeres Afrodescendientes de América Latina y El Caribe”, Curso interdisciplinario
de Derechos Humanos, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 18 de octubre.
Cardoza, Melissa (March 2005). Building Women’s Citizenship and Governance, Central America. Experiences and strategies for women’s
political advocacy. Report from the Central American Feminist Encounter “Women’s Citizenship and Political Participation”, avec le soutien du Community Fund, UK.
Careaga Pérez, Gloria (2001). La diversidad en la propuesta feminista, Quito, Ecuador, Octobre.
Crenshaw, Kimberlé Williams (1991). “Mapping the margins: Intersectionnality, identity politics and violence against women”,
Stanford Law Review, no 43, 1241-1298.
Curiel, Ochy (2003). “Identidades esencialistas o construcción de identidades políticas: El Dilema de las Feministas Negras” dans Red
de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. Discriminación de Género/Raza/ Etnia: Mujeres negras e indígenas alzan su voz.
De Barbieri, Teresita (2002). «Acerca de las propuestas metodológicas feministas». Dans Eli Bartra (sous la direction de.):
Debates en torno a una metodología feminista. México: Pueg/Uam.
______ (2004). Más de tres décadas de los estudios de género en América Latina (2004).
Di Tella, Torcuato; Chumbita, Hugo et Gamba Susana (2001). Fajardo, Paz. Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas. Buenos
Aires : Emecé Editores S.A.
Facio, Alda (2002). Globalización y Feminismo. Tema del IX Encuentro Feminista, Costa Rica. Disponible sur le web: http://www.undp.org.cu/pdhl/Modulo4/use/tema3/doc4.doc
Fougeyrollas-Schewbel, Dominique, Lépinard, Élénore et Varikas, Eleni (2005). “Introduction”, Cahiers du genre, no
39, 5-12.
Ford-Smith, Honor (1988). “Women and the Garvey Movement in Jamaica,” in Rupert Lewis and Patrick Bryan (eds). Garvey: His Work
and Impact. Kingston, Mona: ISER, and UWI Extra Mural Studies Department.
French, Joan et Ford-Smith, Honor (1985). Women, Work and Organisation in Jamaica: 1900-1944, Research Report, The Hague:
Institute of Social Studies.
Gargallo, Francesca (2004). Las ideas feministas latinoamericanas, Mexico: Universidad de Ciudad de México.
Garrido, Beatriz (mars 2004): “Una Lectura sobre la Historia de las Mujeres, la Historia de¡ Género y la Producción Historiográfica
Argentina”, Zona Franca, Argentina, Año 12, no. 13, pp. 3-14.
Gill Lozano, Fernanda, Pita, Valeria Silvina et Ini María Gabriela (2000). Historia de las mujeres en la Argentina, Tome II,
Buenos Aires :Taurus, Siglo XX.
Gómez, Adriana (2003). Discriminación de Género/Raza/Etnia: Mujeres negras e indígenas alzan su voz. La Red de Salud de las
Mujeres Latinoamericanas y del Caribe.
Gutiérrez Aguilar, Raquel (1999) : Desandar el laberinto. Introspección en la feminidad contemporánea, La Paz
(Bolivia): Muela del Diablo editores, 1999.
Guzzetti, Lorena et Fraschini, Mariano (sans date). El movimiento feminista ante las políticas neoliberales de los noventa.
Agenda de las mujeres. El portal de las mujeres argentinas, iberoamericanas y del Mercosur. Disponible sur le web: http://agendadelasmujeres.com.ar/index2.php?id=3¬a=1804.
Kirkwood, Julieta (1987). Feminarios, Santiago: Documentas.
Lamas, Marta (2002). Cuerpo: diferencia sexual y género, Mexico: Taurus.
Lamas, Marta (1996). (sous la direction de), El género: la construcción cultural de la diferencia sexual,
Programa Universitario de Estudios de Género/Miguel Ángel Porrúa editor, México.
Lipszyc, Cecilia (1997), Brujas no. 24, citée dans Lorena Guzzetti et Mariano Fraschini, El movimiento feminista ante las
políticas neoliberales de los noventa, http://agendadelasmujeres.com.ar/index2.php?id=3¬a=1804
Maalouf, Amin (1998). Les identités meurtrières, Paris : Éditions Grasset et Fasquelle.
Maffía, Diana et Kurschnir, Clara (1994). (sous la direction de). Capacitación Política para mujeres: Género y Cambio social en la
Argentina actual. Buenos Aires : Feminaria Editora.
Navarro, Marysa et Sanchez Korrol, Virginia (1999). Women in Latin America and the Caribbean, Restoring Women to
History (1999). Series Editors: Cheryl Johnson-Odim et Margaret Strobel.
Olea, Raquel (1999). « Femenino y Feminismo en Transición », Revista Encuentro XXI, 5, No 15,
Santiago.
Pisano, Margarita (sans date). Una larga lucha de fracasos. Disponible sur le web: VIII Encuentro Feminista Latinoamericano y
del CaribeF:\Articles\ Interseccionalidad\ Feminismos_plurales-Bettina.htmChilena.
Poggio, Sara, Montserrat, Sagot et Schmukler, Beatriz (2001) (sous la direction de), Mujeres en América Latina transformando la
vida, San José, Universidad de Costa Rica.
Reddock, Rhoda (2007). “Diversity, Difference and Caribbean Feminism: The Challenge of Anti-Racism”, Caribbean Review of Gender
Studies, Issue 1, Avril, Disponible sur le web: http://sta.uwi.edu/crgs/journals/diversity-feb_2007.pdf
_________ (juin 2006). Historia del Movimiento de Mujeres del Caribe (1ra parte), Discours prononcé dans le
cadre de la réunion HIVOS/UNIFEM des organisations de femmes, Asociación Caribeña para la investigación y acción feministas, Granada, 1-2 décembre 1998. Disponible sur le web: http://www.cafra.org/article692.html?artsuite=0#sommaire_4
_________ (1994). Women, Labour and Politics in Trinidad and Tobago: A History, London: Zed Books.
_______ (1995).The Early Women’s Movement in the Caribbean” in Saskia Wieringa (ed.) Subversive Women: Women’s Movements in
Africa, Asia, Latin America and the Caribbean, London New Delhi: Zed Books.
Ríos, Marcela, Godoy, Lorena et Guerrero, Elizabeth Guerrero (2004). Un nuevo silencio feminista? La transformación de un
movimiento social en el Chile posdictadura. 2004
Sabanes Plou, Dafne (octobre 2005). Los caminos del feminismo latinoamericano. Disponible sur le web: ALAI-AMLATINA
18/10/2005, Serra Negra, Sao Paulo.- Los debates durante el X Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe
Valenzuela, María Elena et Rangel, Marta (2004). (sous la direction de). Desigualdades entrecruzadas.Pobreza, Género, Etnia y Raza
en América Latina. Oficina Regional de la OIT.
Vargas, Virginia (mars 2003). “Los procesos feministas latinoamericanos en el nuevo milenio: Identidades descentradas en lo nacional y
lo global”, Revista Aportes Andinos,
Emergencia de los Movimientos Sociales en la Región Andina. Disponible sur le web: http://www.uasb.edu.ec/padh/revista
________ (1998). “Los nuevos derroteros de los feminismos latinoamericanos en la década de los 90. Estrategias y discursos”, mimeo,
Lima.
Vicente, Esther (2005). “De la feminización de la pobreza a la feminización y democratización del poder”, dans SELA Panel 1:
La obligación de erradicar la pobreza, Puerto Rico.
'
 L’association Éducation Santé Drôme (ex ADES26) réunissait son
assemblée générale vendredi. Son président, le docteur Luc Gabrielle, note en préambule quelques éléments de réflexion ; l’accroissement des déficits des dépenses sociale, le lien désormais
établi entre mode de vie et santé, la nécessité de réorienter le système de santé vers la prévention et de mesurer l’efficacité de cette dernière et enfin un contexte en pleine évolution avec
notamment une baisse des crédits affecté à la prévention à laquelle il faut s’adapter. Cette association financée entre autre par l’ARS qui regoupe les (DDASS, la DRASS, l'ARH, certains services du conseil général, les URCAM, et certains services des ERSM (praticiens conseils) , et
le Conseil Général de la Drôme , participe à des missions de services publics de santé en menant, en partenariat avec les acteurs locaux des actions d’information, d’observation ou encore
d’études en prenant en compte la globalité des situations (économiques, sociologiques, éducatives etc.). La prévention, l’information sur les comportements à risques ; restent des moyens plus
efficaces et moins couteux, en terme de santé publique, que le traitement des maladies. On le sait, mais on l’oublie souvent, mieux vaut prévenir que guérir.
L’association Éducation Santé Drôme (ex ADES26) réunissait son
assemblée générale vendredi. Son président, le docteur Luc Gabrielle, note en préambule quelques éléments de réflexion ; l’accroissement des déficits des dépenses sociale, le lien désormais
établi entre mode de vie et santé, la nécessité de réorienter le système de santé vers la prévention et de mesurer l’efficacité de cette dernière et enfin un contexte en pleine évolution avec
notamment une baisse des crédits affecté à la prévention à laquelle il faut s’adapter. Cette association financée entre autre par l’ARS qui regoupe les (DDASS, la DRASS, l'ARH, certains services du conseil général, les URCAM, et certains services des ERSM (praticiens conseils) , et
le Conseil Général de la Drôme , participe à des missions de services publics de santé en menant, en partenariat avec les acteurs locaux des actions d’information, d’observation ou encore
d’études en prenant en compte la globalité des situations (économiques, sociologiques, éducatives etc.). La prévention, l’information sur les comportements à risques ; restent des moyens plus
efficaces et moins couteux, en terme de santé publique, que le traitement des maladies. On le sait, mais on l’oublie souvent, mieux vaut prévenir que guérir.